espace pédagogique > disciplines du second degré > histoire-géographie > approfondir
approfondir
penser l'histoire du Monde : une conférence de C. Grataloup (1)

Voici la première partie du compte-rendu d'une conférence donnée par C. Grataloup à Angers le 1er juin 2017. Il s'agit d'un rappel épistémologique sur la mise en place de l'idée de mondialisation.
INTRODUCTION
C. Grataloup est enseignant-chercheur à l'université de Paris-Diderot. Pour lui, on ne peut plus faire d'histoire sans géographie : les questions de localisation des processus sont fondamentales. Notre histoire est géographiquement localisée. On a tendance à ramener l'espace au temps. Dans une large mesure, il faut plutôt ramener le temps à l'espace, les mettre en dialogue.
I. UNE MONDIALISATION SPECIFIQUE : RAPPEL EPISTEMOLOGIQUE
Dans les années 50, le roman national, puis le roman européen sont enseignés dans les écoles. Cette vision du Monde a été remise en cause à la fin des années 70 : c’est le moment de la diffusion du mot mondialisation. Issu du journalisme, il pénètre via la géographie et l’économie le monde savant. Cette prise de conscience du monde, associée à l'idée de progrès et de croissance, est liée entre autres à la crise pétrolière. On comprend que le poids économique et le rôle international des pays ne dépendent pas uniquement des Etats-Unis et de l’Europe. Le Japon prend alors une grande importance dans les débats, et le Pacifique est vu comme un nouveau centre du monde. L’idée de géopolitique renaît. En 1980, le mot mondialisation apparaît dans les dictionnaires ; l’expression système-monde apparaît en 1982 avec Olivier Dolfus.
2. La post-modernité
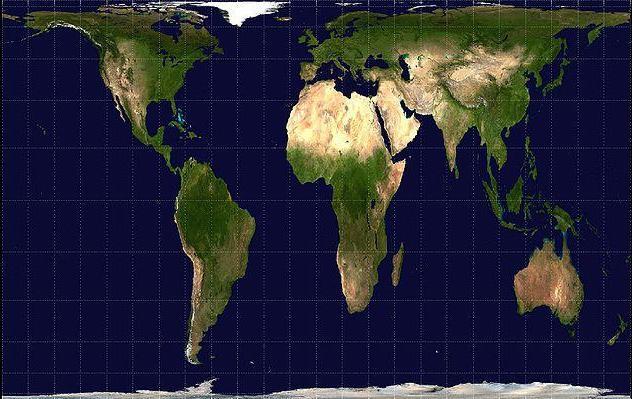
A partir des années 80, c'est la fin de deux grands récits : le structuralisme et le modèle évolutionniste (avec notamment le marxisme). Cette déconstruction intellectuelle est appelée post-modernité. Avec la remise en cause du paradigme moderniste et la modification profonde des rapports économiques et géopolitiques, la géohistoire devient un besoin.
Ainsi, l'image familière du monde (planisphère Mercator orienté au Nord, équateur, méridien de Greenwich placé en 1884) est modifiée. La carte de Stuart Mc Arthur (1979, orientée au Sud) et la projection d'Arno Peters (1973, reprise de James Gall en 1855) deviennent très populaires. Elles reflètent également le mouvement tiers-mondiste.
A gauche : la projection d'Arno Peters (1973), en fait James Gall (1855). Par Penarc — Mdf en.wikipedia, Domaine public, Lien

La diffusion de la post-modernité connaît trois moments principaux :
- L'architecture post-moderne
L'expression post-modernité est d'origine strictement architecturale. L'architecture moderne domine des années 1920 aux années 1970 : l'architecture est rationnalisée, identique partout car adaptée à l'homme. L'idée d'universalité est au coeur de ce mouvement : on peut parler d'une architecture humaniste. Ce n'est pas une architecture de citation (contrairement aux courants "néo..." du 19ème siècle). La post-modernité architecturale veut briser cette uniformité en relocalisant l'architecture, en reprenant le poids du style local et des matériaux locaux (avec Charles Jenks notamment).
A droite : le Ray and Maria Stata Center au MIT (Franck Gehry, 2004) : un bâtiment conçu comme un manifeste d'architecture post-moderne. CC BY-SA 3.0, Lien
- La diffusion de l'expression
Jean-François Lyotard dans La condition post-moderne (1979) popularise l'idée de post-modernité. Cette expression va se diffuser largement, notamment dans les campus d'universités d'Amérique du Nord sous l'influence croisée de textes de Deleuze, Dérida et Foucault, sous le nnom de "théorie française". C'est le moment de l'apparition de "troubles" dans les catégories (genre/sexe, subalterne, économie/écologie, périodes...). Les gender studies envahissent le milieu universitaire, les études post-coloniales se développent.
- La lecture des régimes d'historicité
Kosellec développe deux notions importantes dans son ouvrage Vergangene Zukunft de 1979 : le champ d'expérience et l'horizon d'attente prennent la place des idées de passé et de futur. Il propose de comprendre le passé comme élément de récit permettant de construire au présent notre société. L'horizon d'attente, c'est le présent qu'on construit en fonction d'un imaginaire du futur.
Ces notions sont reprises par François Hartog dans les Régimes d'historicité en 2003. A travers l'exemple de Châteaubriand, il propose une typologie de régimes d'historicités :
- le passéisme : les sociétés qui situent leur âge d'or dans le passé (ex. le retour de l'Antiquité est appelé Renaissance)
- le futurisme : l'âge d'or est situé dans le futur (ex. idée d'une révolution à venir justifiant les sacrifices présents)
- le présentisme : le passé est mis au présent sous la forme de la patrimonialisation. On ne sait plus penser l'avenir.
Ces idées modernistes sont cartographiables dans l'espace occidental : il y a donc un débat politique mondial - les autres pays reprochant notamment à l'Occident son rôle de donneur de leçon (ex. féminisme, animalisme...)
3. Géohistoire et global history : penser à l'échelle du monde
- L'apparition du mot géohistoire
Fernand Braudel utilise pour la première fois ce mot dans une lettre de 1942. Pour lui, il s'agit alors de l'intégration au champ historiographique du champ français de la géographie (marqué par Vidal de la Blache par exemple). Il s'agit d'une histoire environnementalisée. Même s'il reviendra sur ce néologisme plus tard, il est le premier à avoir pensé à l'échelle presque mondiale, s'affranchissant de l'échelle dominante de la Nouvelle Histoire : la région. Il reste cependant dans une trilogie : l'Occident, l'Orient et le reste.
- La notion de global history
La global history apparaît d'abord comme une demande des enseignants du 2nd degré aux Etats-Unis. Là-bas, le cours d'histoire était basé sur le " nous " : " nous avons créé Boston ", " nous avons obtenu notre indépendance "... Ces enseignants montrent une volonté d'adaptation qui aboutit à une histoire qualifiée de globale. Les recherches se multiplient sur le sujet. Cs idées pionnières dans le domaine de l'histoire économique ont pénétré lentement les écoles françaises. On devrait d'ailleurs traduire l'expression par " histoire mondiale ".
Lien vers la partie n°2
Lien vers la partie n°3
histoire-géographie-citoyenneté - Rectorat de l'Académie de Nantes

 s'identifier
s'identifier
 portail personnel ETNA
portail personnel ETNA