Les enseignantes ont aussi fait des choix sur les modalités pédagogiques de l'enseignement de la négociation, privilégiant le jeu de rôle. Sur des scénarios qui évoluent progressivement au fil des quatre heures, les élèves passent du rôle de vendeur à celui d'acheteur et d'observateur. Ainsi, pour travailler la prise de contact, en anglais, par exemple, la classe est organisée en triades sur quatre groupes : un vendeur, un acheteur et un observateur. Chaque groupe reçoit les fiches jeu de rôles (
voir annexe). Après avoir décidé qui fait quoi pour commencer, les étudiants prennent cinq à dix minutes pour se mettre dans le rôle. Et la simulation commence aussitôt. La classe est animée. Pour approcher au mieux la situation, les étudiants se déplacent, sortent de la salle, puis rentrent. Cette effervescence n'est pas pour leur déplaire ! Après chaque essai, le vendeur, puis l'acheteur s'autoanalysent et écoutent l'observateur. Au fur et à mesure des simulations, les erreurs sont gommées, les oublis se raréfient et la technicité se révèle. Les deux professeures observent deux triades chacune. Elles laissent les étudiants évoluer, conseillent parfois, font rejouer si nécessaire. L'investissement est total et se fait dans un climat de confiance. Pas d'enregistrement vidéo qui risquerait de bloquer les élèves. On reste dans du vivant, de l'éphémère, comme dans les situations réelles en entreprise, sous le seul regard des autres étudiants et des enseignants.Double regardLes configurations varient souvent. En anglais, les treize étudiants sont répartis en trois ou quatre groupes, qui fonctionnent parallèlement, comme on l'a vu ; parfois, aussi, un seul petit groupe agit sous le regard du reste de la classe, ce qui permet un débriefing général. C'est le cas, par exemple, quand une des enseignantes a repéré qu'un groupe a mis en place un scénario particulièrement intéressant pour faire évoluer une pratique, repérer un obstacle. Ce retour peut permettre, en fin de séance notamment, de tout recadrer, de faire le bilan sur les apprentissages réalisés, de les formaliser. La taille du groupe est déterminante pour que la mise en place de ces activités soit vraiment efficiente : si les étudiants sont trop peu nombreux, l'émulation ne joue pas pleinement et, au-delà de douze, en revanche, l'observation active de l'enseignant devient difficile, tout comme l'inter-action, la mise en synergie des petits groupes. Les temps d'analyse après chaque simulation sont en effet essentiels pour repérer les éléments positifs et perfectibles, mettre en évidence les éléments - langagiers ou non - de la communication qui ont fait défaut, et mettre en place de nouveaux scénarios susceptibles de permettre aux étudiants de s'adapter à une situation imprévue : un acheteur revêche, une attente imposée, un double interlocuteur... S'il est assez facile, pour les deux professeurs en coanimation, de repérer le respect ou non des différentes étapes techniques de la phase de prise de contact, il est plus difficile d'expliquer à l'étudiant comment il peut progresser. En effet, l'acquisition des techniques par les étudiants ne pose pas de problème en général ; cependant, tout le travail consiste à devenir professionnel, à gagner en naturel et en réactivité. Cette phase de retravail des comportements est beaucoup plus délicate, les corrigés n'existent pas. J'ai trouvé, à ce moment de la formation, que le double regard s'avérait souvent riche et permettait de mieux atteindre les objectifs, note Y. Bruneau.
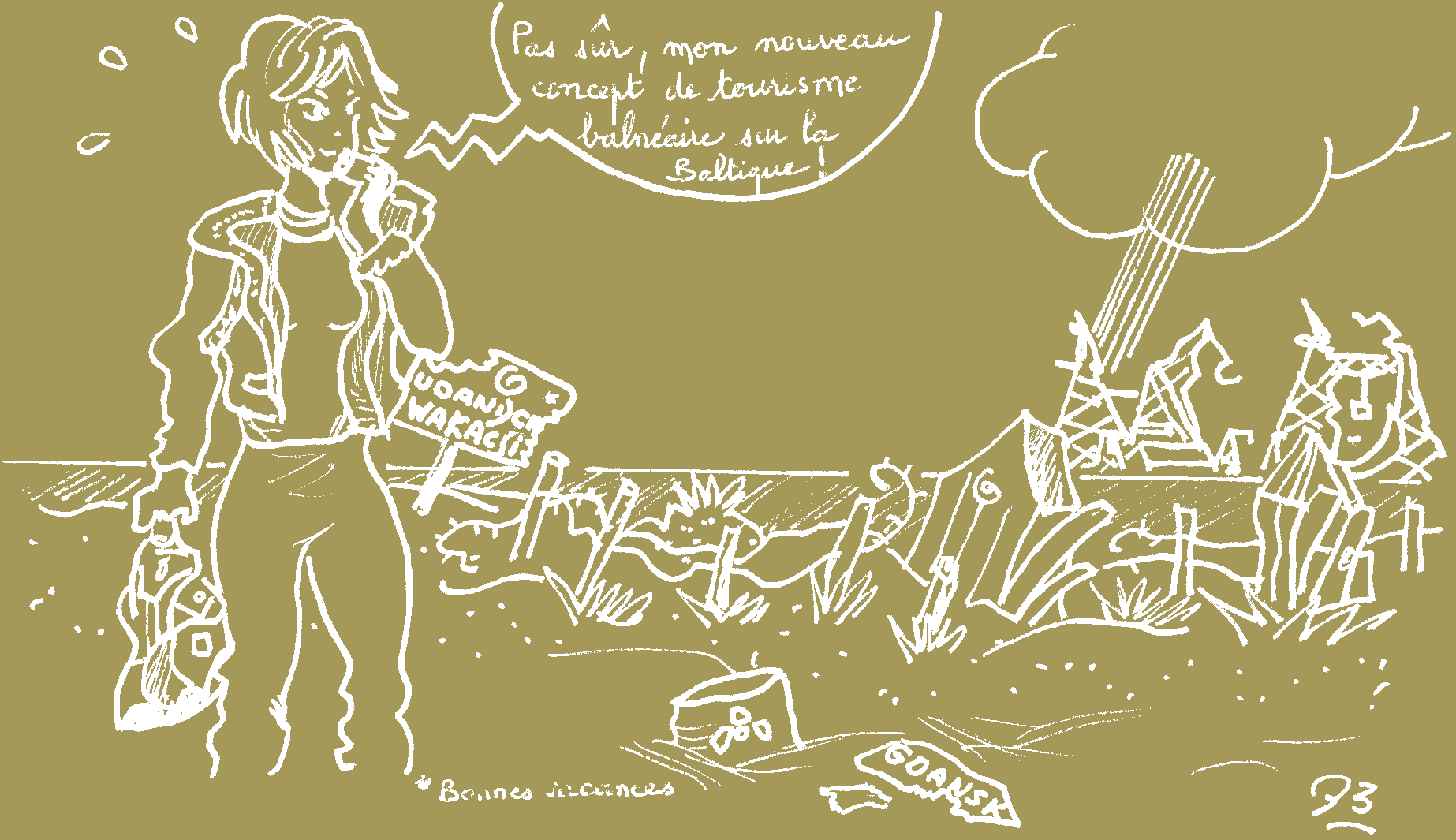
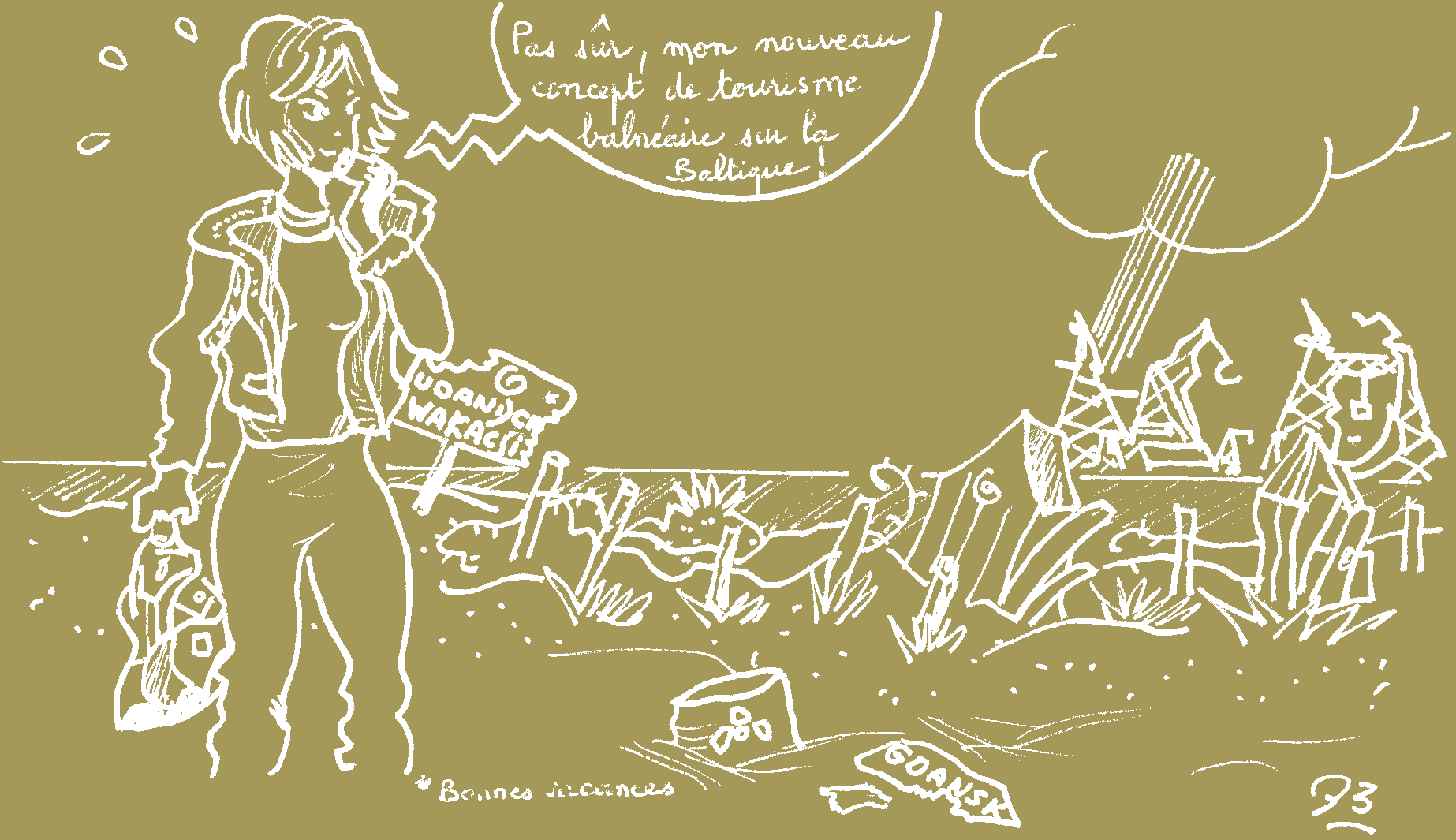


 s'identifier
s'identifier
 portail personnel ETNA
portail personnel ETNA
