espace pédagogique > actions éducatives > innovation pédagogique > échanger
classe renversée en 5e via un EPI sur le développement durable
mis à jour le 27/11/2018
Au collège de Segré, M. Loiseau et M. Orain, tous deux enseignants d’histoire-géographie-EMC, ont expérimenté avec la participation de Mme Lagault, professeure documentaliste, un processus de classe renversée au cours d’un EPI sur le développement durable mené pendant treize semaines pour toutes les classes de cinquième (120 élèves). Comment enseignants et élèves appréhendent-ils cette façon radicalement nouvelle de travailler sur un projet long ? Peut-on en tirer des enseignements sur une autre façon de permettre aux élèves de s’approprier les savoirs et de renouveler leur mobilisation sur les apprentissages ?
mots clés : échanger, classe renversée, EPI, différenciation, tâche complexe
Les élèves se mettent ensuite au travail et expérimentent la construction d’un savoir de A à Z, du choix du sujet à la présentation à leurs pairs de cette connaissance. Dans un premier temps, les collégiens mènent une réflexion sur le choix du sujet et se mettent en groupe (de trois le plus souvent) librement à partir des sujets choisis. Puis, à l'aide de plusieurs fiches-guides remises en début de séance, ils sont invités à trouver une problématique, un plan, des exemples, et à débuter leurs recherches sur divers supports de leur choix. Durant ces séances, les enseignants, une fois le cadre posé, se taisent et circulent dans les groupes, se limitant à répondre aux questions des élèves. Entre deux séances, ils annotent les fiches-travail de chaque groupe pour leur permettre d’avancer lors de la séance suivante. Les élèves, pour leurs recherches, ont recours principalement aux ressources du CDI : la professeure documentaliste réalise à cet effet une présentation de plusieurs ressources et incite les élèves à utiliser le logiciel de recherche du CDI ; la médiathèque municipale et internet permettent de compléter cette base de données. M. Loiseau note aussi que "pour certains le travail de recherche se poursuit en dehors des séances et sans demande explicite de la part des enseignants. Certains groupes fournissent aussi un travail intense pendant les vacances scolaires et sollicitent les enseignants via e-lyco". Ensuite, une fois le recueil d’informations jugé satisfaisant et le plan clairement défini, vient le temps de la réalisation de l’exposé. Trois types de supports sont choisis par les élèves, ici encore librement et sans préconisation des enseignants : l’affiche A3 (pour une majorité de groupes), le diaporama et pour quelques groupes la vidéo. M. Loiseau souligne que tout au long du travail "les enseignants sont plus attentifs aux groupes les moins avancés et tentent de les aider dans leurs recherches". Il ne s’agit donc pas d’une autonomie totale et radicale, mais plutôt du choix de laisser les élèves aller le plus loin possible seuls dans la recherche, la construction des savoirs et de n’intervenir qu’à leur demande lorsqu’un blocage majeur, tel un désaccord important dans le groupe ou une incapacité à recueillir, trier et/ou mettre en forme des informations empêche la progression du travail des élèves.
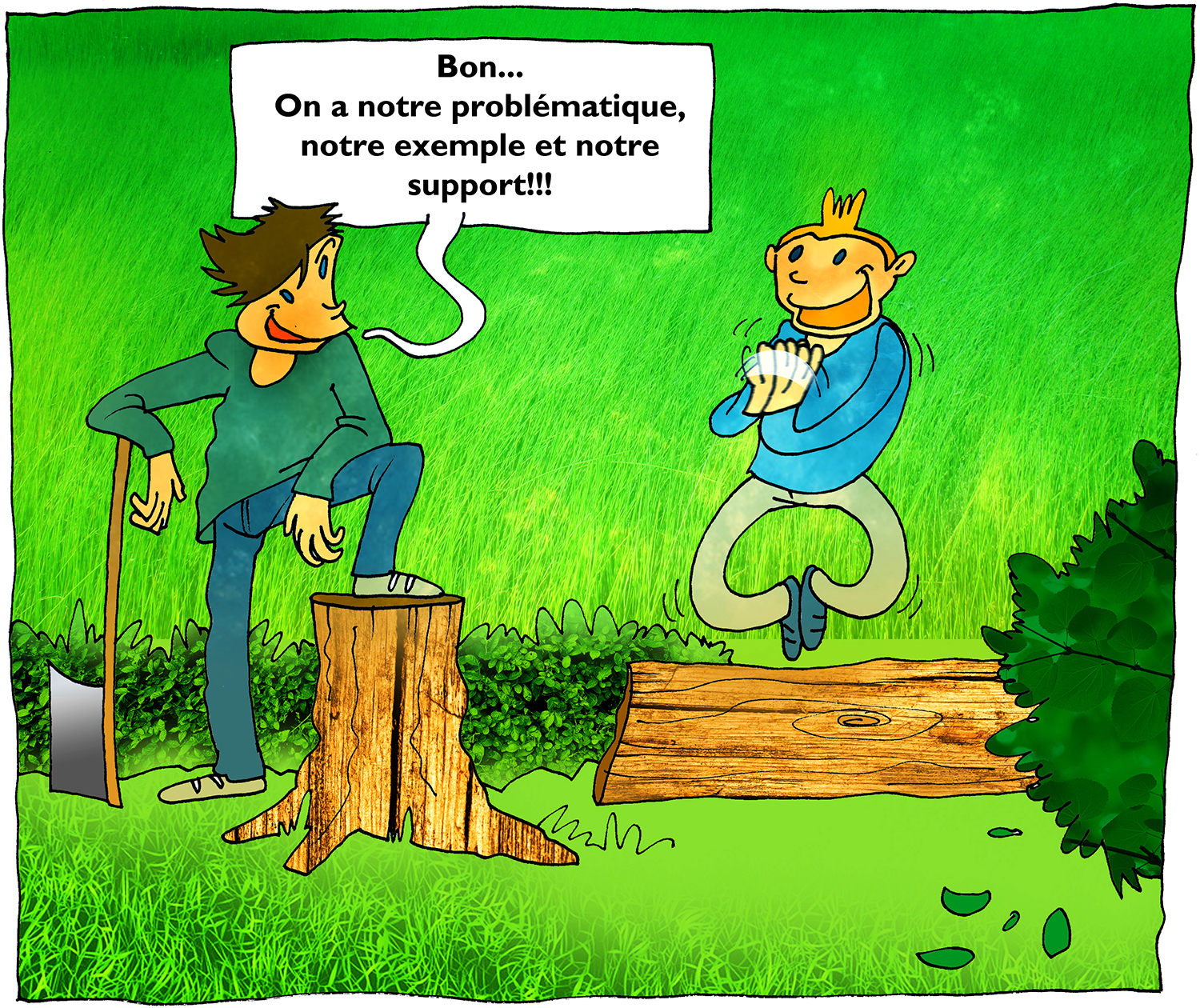
En conclusion, il faut bien dire que si d’aucuns considèrent la classe renversée comme une liberté totale d’agir pour les étudiants, ce n’est pas applicable au collège où les élèves ont besoin d’accompagnement. Il ne s’agit pas non plus de faire de la classe renversée une panacée et une pratique absolue et systématique, ce qui ne paraît ni réaliste ni même souhaitable. Une expérience de classe renversée, si elle rejaillit sur l’ensemble d’une pratique d’enseignant peut tout à fait se conjuguer avec des pratiques plus conventionnelles à d’autres moments. En revanche M. Loiseau prolonge l’expérimentation en proposant une pratique de classe renversée "moins ambitieuse et plus abordable pour chaque enseignant". Il s’agit d’un projet sur deux heures où les élèves se retrouvent à choisir un thème et doivent ensuite bâtir un quiz avec l’aide de Learnup. Quant aux projets plus ambitieux, M. Loiseau et ses collègues n’y renoncent pas, proposant pour l’année scolaire 2018-2019, avec les classes de troisième du collège et dans le cadre du concours national de la résistance et du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, un projet selon la méthode de la classe renversée dont le point de départ est le témoignage d’une résistante de 92 ans devant les élèves.
S. Billon
contributeur(s) :K. Loiseau, D. Orain, C. Lagault, Collège Georges Gironde, Segré [49]
ressource(s) principale(s)

|
enseigner dans un environnement numérique de travail | 24/10/2011 |
| L'ENT est "un dispositif global fournissant à un usager un point d'accès, à travers les réseaux, à l'ensemble des ressources et des services numériques en rapport avec son activité. Il ... | ||
| échanger, ENT, E-Lyco, communication, équipe | ||
innovation pédagogique - Rectorat de l'Académie de Nantes

 s'identifier
s'identifier
 portail personnel ETNA
portail personnel ETNA

